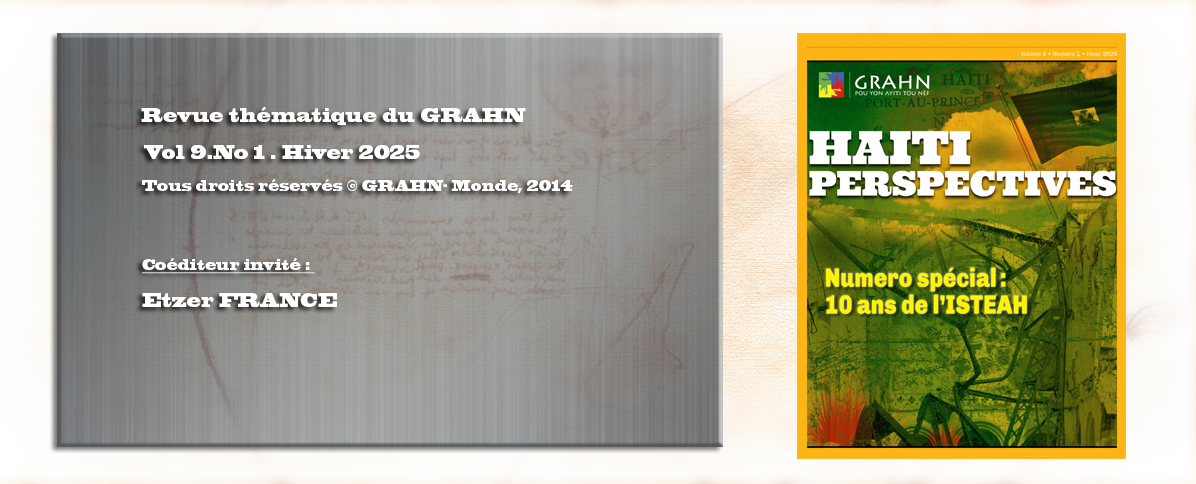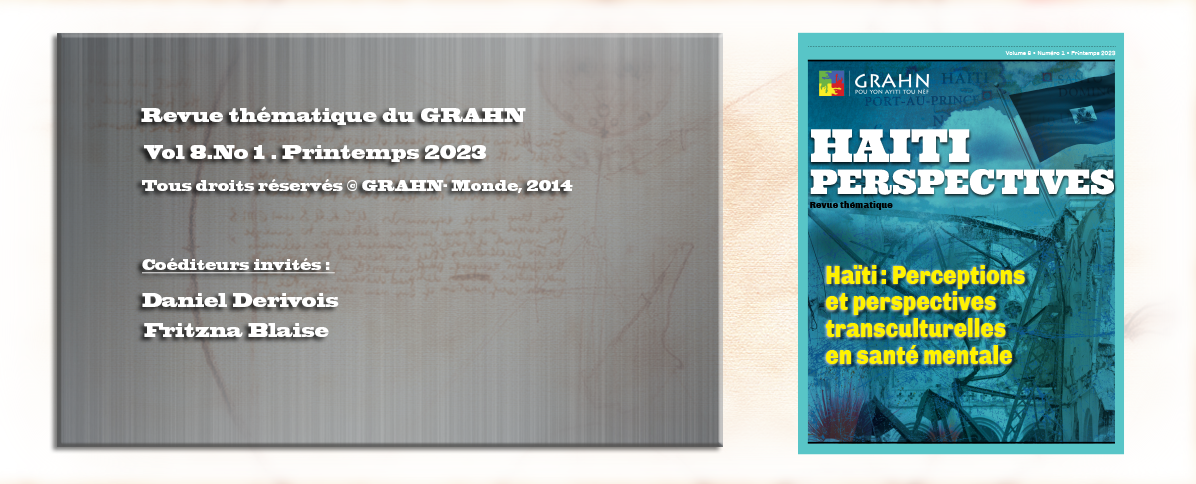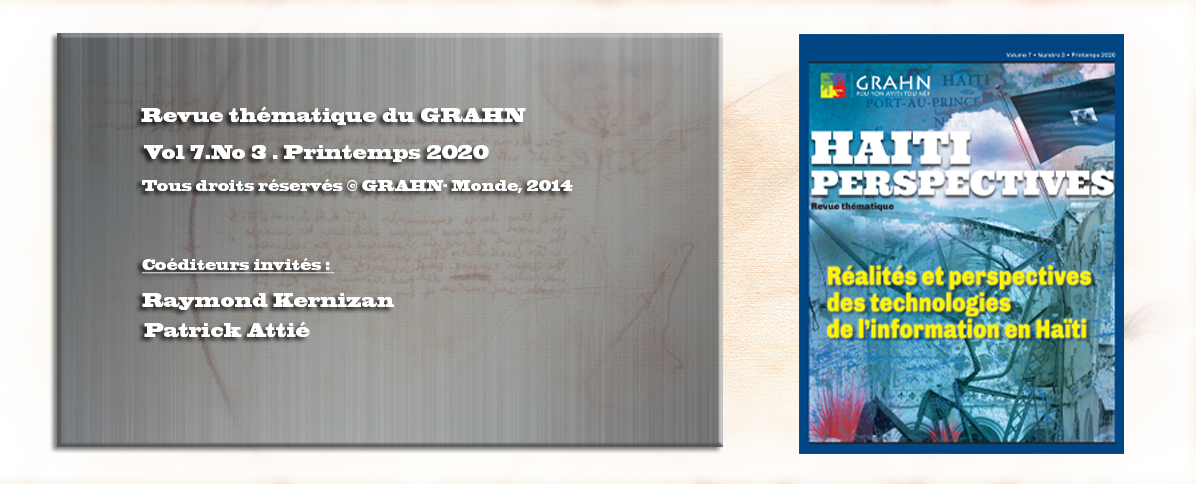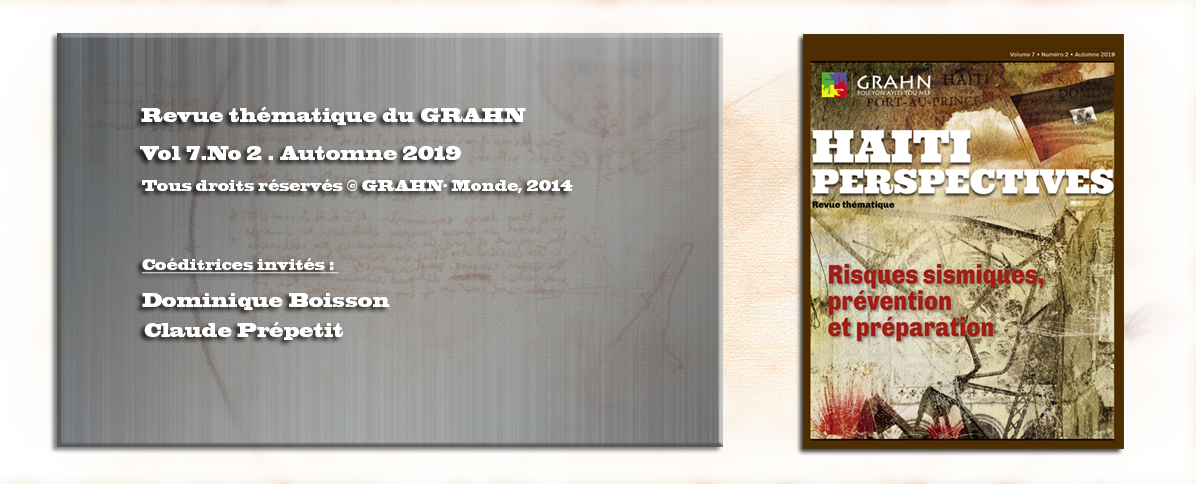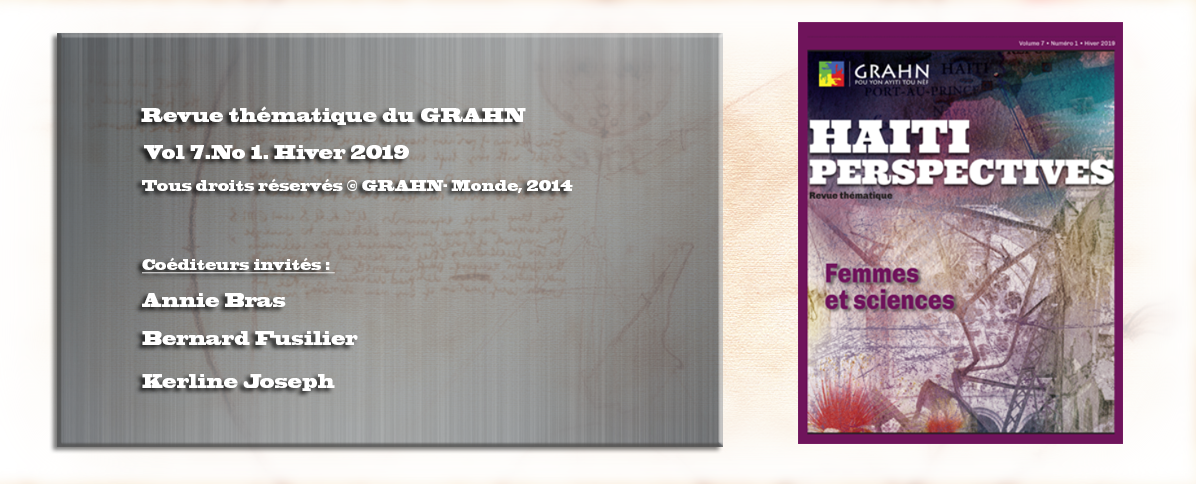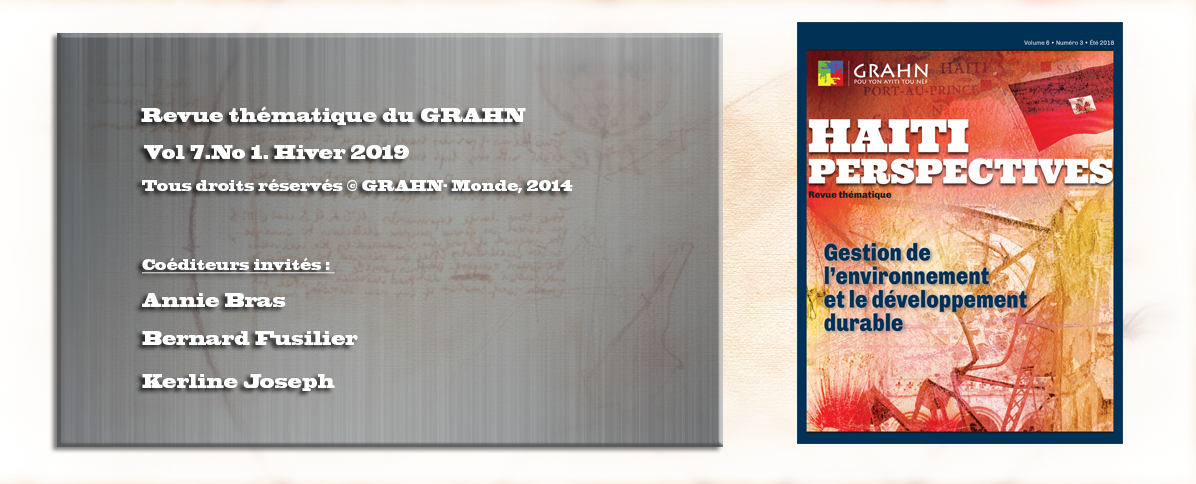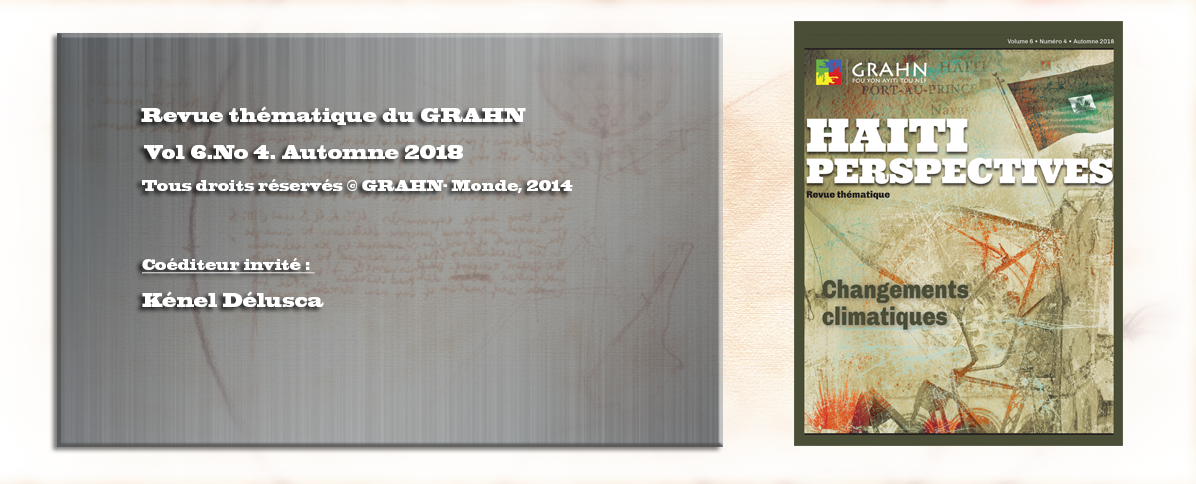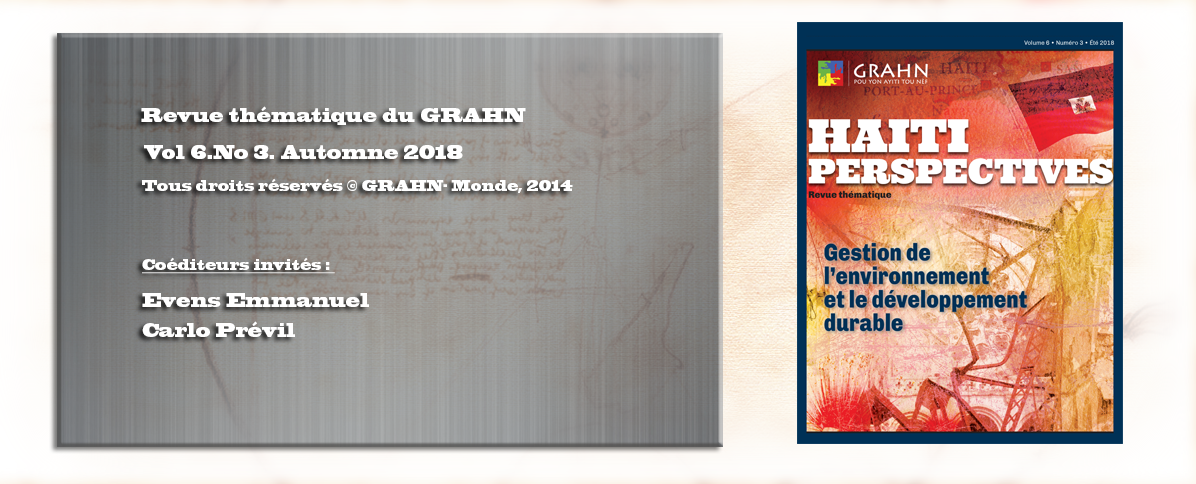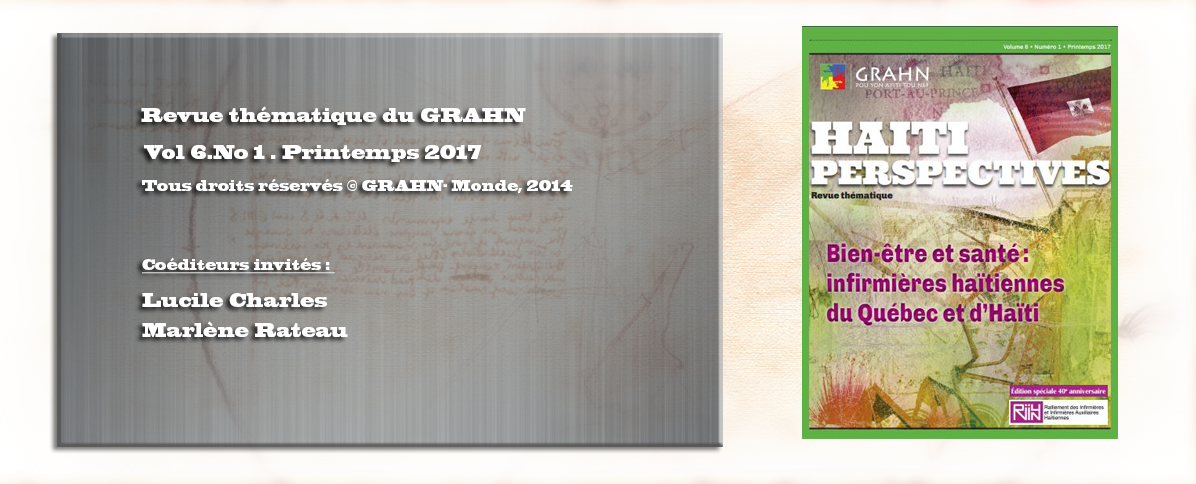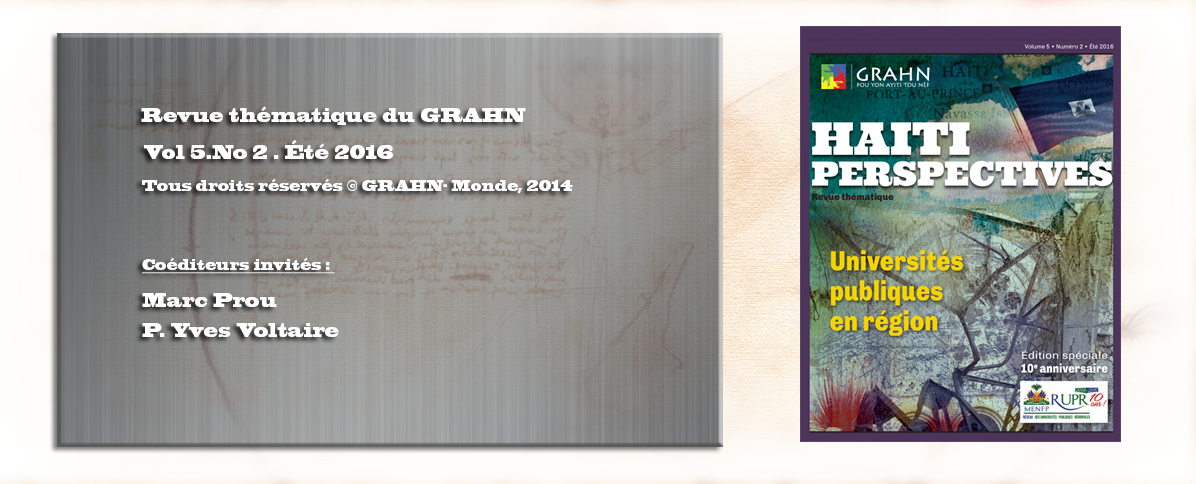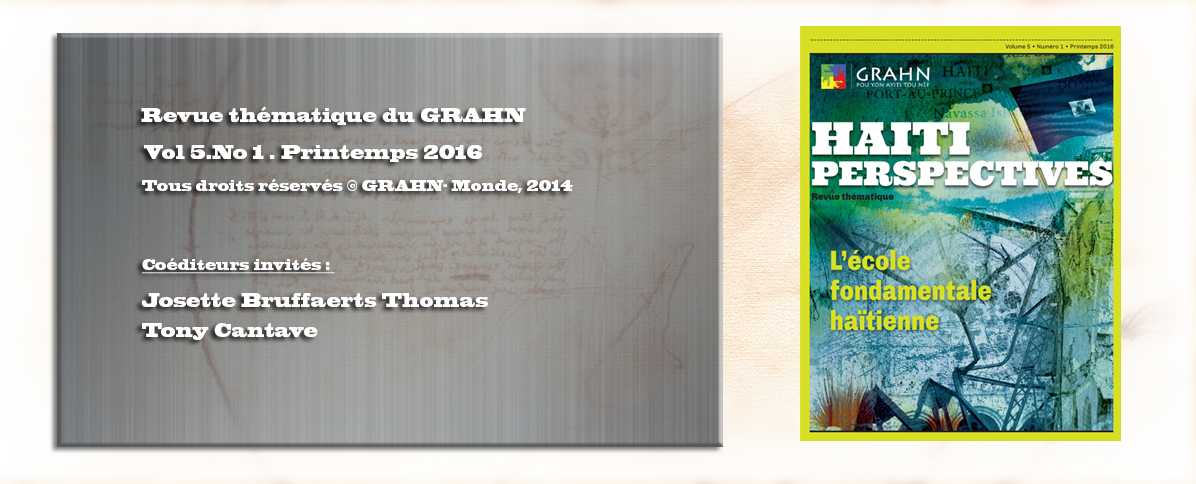Retrouvez notre prochain numéro
ÉDITORIAL
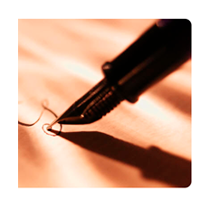 Déjà plus de 10 ans… L’ISTEAH 2.0
Déjà plus de 10 ans… L’ISTEAH 2.0
Écrit par Samuel PIERRE
L’Institut des Sciences, des Technologies et des Études Avancées d’Haïti (ISTEAH) a vu le jour le 14 janvier 2013.
L’aventure a débuté le 20 janvier 2010 lorsque – 10 jours après le terrible séisme qui a frappé durement le département de l’Ouest d’Haïti en y causant des dégâts humains et matériels sans précédent – une vingtaine de personnes se sont réunies à Polytechnique Montréal pour fonder le Groupe de réflexion et d’action pour une Haïti nouvelle : le GRAHN.
Devant l’engouement manifesté par des personnes d’autres pays, nous avons eu l’idée d’étendre la portée géographique du mouvement en créant GRAHN-Monde.
Aujourd’hui, le GRAHN dispose de branches dans cinq pays : Canada, États-Unis, France, Haïti et Suisse.
GRAHN-Monde, c’est aussi près d’une vingtaine de chapitres éparpillés dans autant de villes ou régions, de Port-au-Prince au Cap-Haïtien, en passant par Boston, Montréal, Ottawa/Gatineau, Québec, Trois-Rivières, Genève et Paris.
C’est enfin plus de 400 membres réguliers, incluant 12 membres institutionnels, auxquels s’ajoutent plus de 4000 sympathisants à travers le monde.
Dans cet éditorial, nous retraçons la trajectoire unique de cet établissement universitaire innovant, qui se distingue par son modèle d’enseignement hybride alliant le présentiel et le distanciel, par son fort ancrage dans la recherche et la formation liée à la recherche, ainsi que par son engagement en faveur de la décentralisation du pays et de l’équité géographique.
ANALYSE
 Questions curriculaires : Conditions d’implantation d’une innovation curriculaire
Questions curriculaires : Conditions d’implantation d’une innovation curriculaire
Philippe Jonnaert
Ce texte a une portée curriculaire.
Il se situe dans le contexte actuel de la mise en œuvre du programme de formation révisé pour la formation initiale des professeur.e.s de collège à l’École Normale Supérieure (ENS) d’Abidjan.
Il vient en appui à l’exposé du professeur Jonnaert lors de l’atelier des 11 et 12 octobre 2023, organisé à l’ENS d’Abidjan avec les professeur.e.s de l’ENS impliqués dans la mise en œuvre du programme de formation révisé.
L’exposé du professeur Jonnaert rappelle trois dimensions de la mise en œuvre d’un nouveau programme :
-
La recherche d’un équilibre entre les anciennes approches et les nouvelles pratiques professionnelles intégrant les six composantes du recadrage proposé dans le programme de formation révisé ;
-
Le phasage en trois étapes de la mise en œuvre d’une réforme curriculaire suggéré dans le modèle de Depover et Strebelle ;
-
Le cheminement du travail curriculaire depuis le processus d’implémentation jusqu’à celui de l’implantation d’un nouveau programme de formation.
L’ensemble des propos du professeur Jonnaert est teinté par une orientation inspirée des travaux empiriques et théoriques piagétiens, comme de ses propres travaux curriculaires sur de nombreux systèmes éducatifs.
Les réalisations évoquées en ces lignes sont issues du projet financé par le Millenium Challenge Account – Côte d’Ivoire, qui a accordé le mandat au consortium C2D-WEI pour la Révision des curricula de formation initiale, des outils de supervision et d’inspection des enseignants bivalents du secondaire du Ministère de l’Éducation Nationale et de l’Alphabétisation (MENA).
![]()
La gouvernance de la sécurité en Haïti:monopolisation, multilatéralisme ou coproduction?
Figaro AURÉLUS
Depuis quelques années, Haïti est confrontée à une insécurité intenable ; des bandes armées font régner la terreur dans le pays, en particulier dans le Bas-Artibonite et la zone métropolitaine de Port-au-Prince. En dépit de certains efforts de la Police nationale d’Haïti (PNH), souvent au prix de très lourds tributs, la situation ne semble pas près de s’améliorer. La quête d’une solution à cette crise sécuritaire fait naître deux grandes positions : d’un côté, il y a ceux qui rejettent la détérioration des conditions sécuritaires sur la mauvaise gouvernance de l’État et, de l’autre, ceux qui fustigent carrément la PNH, qu’ils jugent responsable de cet état de fait.
Ce travail cherche à explorer le modèle de gouvernance de la sécurité appliqué en Haïti. Utilisant la méthode documentaire, il analyse, à partir des données provenant des travaux des chercheurs du domaine comme Sébastian Roché, Pregnon Claude Nahi, Jacques Chevallier, Samuel Tanner et al. et Dirk Brand, trois modèles de gouvernance de la sécurité, à savoir : la monopolisation, le multilatéralisme et la coproduction. Il en ressort qu’Haïti, État faible et défaillant, utilise une hybridation dans la gouvernance de la sécurité, et que d’autres entités sont impliquées, aux côtés de la police, dans la production de la sécurité. Une bonne articulation de ces dernières permettra d’appréhender la crise sécuritaire et d’explorer des pistes de solution.
10 ans d’Excellence: les nouveaux docteurs de l’ISTEAH racontent leur trajectoire
 10 ans d’Excellence: les nouveaux docteurs de l’ISTEAH
10 ans d’Excellence: les nouveaux docteurs de l’ISTEAH
racontent leur trajectoire
L’avènement de l’Institut des Sciences, des Technologies et des Études Avancées d’Haïti (ISTEAH) en tant qu’institution d’enseignement supérieur en Haïti:
Écrit par Jacques ABRAHAM
Le mois de septembre 2023 a amené le 10e anniversaire de l’Institut des Sciences, des Technologies et des Études Avancées d’Haïti (ISTEAH) en tant qu’institut d’enseignement supérieur en Haïti. En cette occasion, il m’a été demandé de réfléchir à un article scientifique non seulement pour marquer cet événement ô combien spécial, mais aussi pour mettre en évidence les contributions scientifiques des docteurs et doctorants de l’ISTEAH. Dans ce contexte, il m’a semblé tout à fait opportun d’analyser les différents travaux de recherche réalisés par les docteurs et les doctorants, et du coup, d’aborder la question de savoir ce que l’ISTEAH a ajouté au niveau initial des étudiants qu’il a accueillis.
L’ISTEAH a su, tout au long de notre étude doctorale, développer chez les étudiants, peut-être moins bien dotés au départ des meilleures chances de réussite, les connaissances et les capacités qui ont permis leur succès. En effet, bon nombre de travaux de recherche ont été réalisés par les docteurs et doctorants. Il y en a qui mettent l’accent sur l’analyse des pratiques de gouvernance de proximité [1], sur les représentations sociales qu’ont les enseignants de leurs rôles dans l’éducation à la citoyenneté et l’analyse de leurs pratiques à l’école fondamentale en Haïti [2], l’analyse de supervision [3] ; tandis que d’autres font état de la démarche de gestion prévisionnelle des ressources humaines académiques dans les IES [4], la pertinence sociale des programmes de formation universitaire [5], alors que François et Jean Baptiste s’interrogent respectivement sur les facteurs susceptibles d’influencer l’intégration des TIC dans la formation technique et professionnelle [6] et sur les services éducatifs préscolaires [7].
Dans cette perspective, on peut déduire que la contribution de l’ISTEAH aux étudiants ou la valeur ajoutée de la formation s’apparente à cette valeur supplémentaire que l’institution a inculquée aux étudiants, grâce au dispositif de formation mis en place, sans lequel ces docteurs et doctorants ne seraient pas aussi performants.
À peine dix années d’existence et la jeune institution qu’est l’ISTEAH compte déjà à son actif 14 docteur.e.s. Comment a-t-elle pu réaliser cet exploit dans un environnement aussi hostile au savoir et à la science ? Dans une société où les hors-normes font et deviennent les normes, où l’instruction a perdu son sens d’origine ou n’est plus ce qu’elle était, jadis, à l’école ? Autant de questions d’ordre épistémologique auxquelles les réponses peuvent paraître paradoxales. Notre propos n’a pas la prétention d’y répondre ; au contraire, il vise à expliquer la valeur ajoutée de la formation de haute qualité fournie par l’ISTEAH. Plus précisément, il cherche à répondre à la question suivante : comment la formation universitaire reçue à l’ISTEAH contribue-t-elle à créer chez les étudiants non seulement une accumulation peu commune de capital scientifique, mais aussi un déplacement dans leur champ social, tout en participant à jeter les bases d’une Haïti nouvelle ?
Nous avons utilisé une méthodologie combinée en arrimant des entretiens exploratoires semi-dirigés organisés de manière informelle et par téléphone avec certains docteurs et l’analyse de dix de leurs thèses. Cet article comporte huit parties ; la première contextualise et pose la problématique ; la deuxième présente la formation académique du jeune chercheur ; la troisième met en exergue le résumé de sa thèse de doctorat ; la quatrième analyse son expérience professionnelle au regard de la formation reçue ; une cinquième partie montre de manière succincte la motivation des étudiants à entreprendre des études à l’ISTEAH ; la sixième explique la valeur ajoutée de la formation doctorale de l’ISTEAH ; la septième essaie de comprendre le lien que cette formation a avec la nouvelle Haïti ; enfin, la dernière partie présente les différentes perspectives pour un changement durable.
Mots clés : valeur ajoutée, capital scientifique, champ social, ségrégation scolaire, discrimination sociale, socialisation discriminative, rapports sociaux d’inégalité, reflet.
![]()
Un homme formé au service de l’Haïti nouvelle
Écrit par Jean Judson JOSEPH
De retour en Haïti en 1917, le docteur Jean Price Mars a prononcé, à l’intention de la jeunesse, une série de conférences publiées en 1919 sous le titre « La vocation de l’élite ». Le concept d’élite, selon l’auteur, fait référence à la classe des dirigeants. En observant l’inaction de cette classe, il n’a pas caché ses déceptions en ces termes : « L’une des choses qui m’ont le plus vivement impressionné, au retour de ma mission en France, il y a deux ans, c’est le désarroi dans lequel j’ai trouvé l’élite de ce pays depuis l’intervention américaine dans les affaires d’Haïti. » (Mars, 1913). Que doivent faire les élites dans un temps donné pour redresser une situation alarmante ? Une élite intellectuelle inactive qui ne constitue pas une masse critique visant le changement du cours de l’histoire n’a-t-elle pas raté sa vocation ?
En effet, presque un siècle après l’apparition de la vocation de l’élite, et particulièrement après le tremblement de terre du 12 janvier 2010, des intellectuels d’horizons divers se mettent à contribution en créant GRAHN-Monde (Groupe de Réflexion et d’Action pour une Haïti Nouvelle), une organisation mondiale de vigie citoyenne. Parmi les actions posées pour redresser la situation d’Haïti, il a lancé en 2013 un programme qui vise à former des scientifiques pour Haïti en créant l’université de la nouvelle Haïti qu’est l’Institut des Sciences, des Technologies et des Études Avancées d’Haïti (ISTEAH).
Après l’examen du dossier et la réussite au concours d’admission, Jean Judson Joseph a reçu une lettre d’admission le 4 novembre 2013 l’autorisant à intégrer l’étude doctorale. À la fin du cycle d’études, il a soutenu sa thèse le 29 avril 2019 et a reçu son diplôme de Philosophia Doctor (Ph. D.) à la cérémonie de collation des grades dans la Cité du savoir à Milot, au nord d’Haïti, le 30 août 2019. Alors qu’il fait dorénavant partie de l’élite intellectuelle du pays, en quoi sa formation académique et plus particulièrement ses études doctorales à l’ISTEAH apportent-elles une contribution au développement d’Haïti ?
Le présent document vise à répondre à cette question en mettant d’abord l’accent sur la formation académique et un résumé de sa thèse de doctorat. Ensuite, ses expériences professionnelles seront brièvement présentées. Enfin, sa motivation à entreprendre cette étude, la valeur ajoutée de la formation doctorale à l’ISTEAH en lien avec une Haïti nouvelle et les perspectives seront exposées.

Le parcours d’un diplômé de la première cohorte de l’ISTEAH
Écrit par Jean-Michel CHARLES
Animé par l’esprit d’entraide et l’amour pour l’éducation depuis ma tendre enfance, j’ai vite compris qu’une voie favorable m’était tracée dans le secteur de l’enseignement et de la formation. Très tôt, j’ai commencé à appuyer mes camarades de classe en plus de fournir gracieusement un encadrement à des jeunes de mon entourage pour la compréhension des matières de base tant au primaire qu’au secondaire. J’avais un sens très poussé pour les techniques, la physique et les astres. Déjà en 6e secondaire, j’achetais des encyclopédies de la jeunesse, des dictionnaires de français, d’anglais et d’espagnol. J’avais ma petite bibliothèque avec des livres de Guy des Cars, Barbara H. Cartland, Dale Carnegie. Tandis que j’étais en classe de 3e secondaire, je lisais déjà des ouvrages qui m’ont poussé davantage à la recherche d’une meilleure compréhension du monde. Je lisais Le défi mondial de Jean-Jacques Servan-Schreiber, le livre de Frantz Fanon Peau noire, masques blancs paru aux Éditions du Seuil en 1952. Parallèlement, je savourais avec joie et enthousiasme le fameux ouvrage du Dr Jean Price-Mars, Ainsi parla l’oncle, qui explore les traditions, les légendes du vodou et l’héritage africain qui fondent les cultures noires. Cela m’a permis d’apprécier les efforts de nos pères pour contribuer à la construction d’un monde égalitaire où l’humanisme serait au centre.
D’un autre côté, le livre Comprendre les femmes et leur psychologie profonde ainsi que les autres livres du psychologue français Pierre Daco m’ont beaucoup interpellé. Mélomane attiré par l’art, je connaissais par cœur les textes d’Aragon, de Paul Verlaine, de Massillon Coicou dont la poésie a donné ses lettres de noblesse à la littérature haïtienne du 19e siècle et l’incontournable Oswald Durand, considéré comme le poète national d’Haïti. Il est le parolier du chant national Quand nos Aïeux brisèrent leurs entraves, qui fut l’hymne national haïtien de 1893 à 1904. J’ai également trouvé très profondes les réflexions de Confucius, les citations de Winston Churchill, homme politique, premier ministre de l’Angleterre. Il écrivait : « Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité, un optimiste voit l’opportunité dans chaque difficulté. »
J’ai été sensibilisé par le courage et la conviction exprimés dans les livres de Turday Lobsang Rampa en plus du fameux livre d’Henri Charrière : Papillon. J’ai lu avec une rare attention les livres de Cheikh Anta Diop, un grand auteur de l’Afrique de l’Ouest qui a montré l’apport de l’Afrique et en particulier de l’Afrique noire à la culture et à la civilisation mondiales. J’ai lu ses livres Nations nègres et culture (1955), puis Civilisation ou Barbarie (1981), qui affirment la primauté civilisationnelle africaine. Ce grand auteur a été un précurseur dans sa volonté d’écrire l’histoire africaine précédant la colonisation.
J’ai fait mes études secondaires à Port-au-Prince tandis que j’habitais à Carrefour dans la partie sud de la ville. J’ai toujours trouvé les réserves nécessaires pour poursuivre mes études classiques et apprendre d’autres choses parallèlement. Ainsi ai-je appris la comptabilité, la dactylographie, la téléphonie, l’anglais niveaux 1 à 4, avant même de terminer mes études classiques.
Dans cette présentation, nous allons surtout vous présenter notre parcours académique, le résumé de notre thèse de doctorat, notre expérience professionnelle, les raisons qui nous ont poussé à entreprendre des études doctorales à l’Institut des Sciences, des Technologies et des Études Avancées d’Haïti (ISTEAH). Nous décrirons ce que cette nouvelle structure universitaire a apporté dans notre vie professionnelle en termes de valeur ajoutée. Suivront notre vision du lien de cette formation avec la construction d’une Haïti nouvelle ainsi que nos perspectives pour les 10 ans à venir.

Impacts de la formation universitaire reçue à l’ISTEAH sur mon cheminement professionnel
Écrit par Irvings JULIEN
Depuis environ dix années, l’enseignement supérieur en Haïti est en pleine mutation. Nous assistons à une prolifération grandissante des universités, des facultés dans les grandes villes du pays. Cependant, cette massification ne traduit pas l’accès à une formation universitaire au niveau des trois cycles (licence, maîtrise et doctorat) de qualité. La majorité des 178 institutions universitaires reconnues par le Ministère de l’Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle (MENFP) et celles qui fonctionnent sans avoir une autorisation offrent une formation conduisant à l’obtention d’un diplôme de licence [1]. Rappelons qu’en grande partie, les étudiants n’arrivent pas à décrocher ce diplôme parce qu’ils ne peuvent pas produire le mémoire exigé au premier cycle universitaire en Haïti [2]. De toutes ces institutions, quelques-unes offrent un ou des programmes de maîtrise et de doctorat.
L’enseignement supérieur en Haïti fait face à de nombreux défis. Dans la plupart des universités, les professeurs n’ont pas un niveau de formation supérieur au cycle qu’ils enseignent. Le corps professoral est constitué majoritairement de licenciés et de maîtres (avec une maîtrise). Une part très faible de personnes détient un diplôme de doctorat. La pénurie de ressources humaines qualifiées et compétentes [2] est l’une des contraintes des institutions d’enseignement supérieur en Haïti. Il faut mentionner aussi la pénurie de matériel et d’infrastructures physiques adéquates au sein des institutions, en plus du faible nombre de productions scientifiques. D’ailleurs, rares sont les universités qui possèdent un espace approprié pour la documentation (physique ou virtuelle) fournissant la possibilité aux étudiants et aux professeurs de pratiquer la recherche documentaire et scientifique. Très peu fonctionnent avec une connexion à Internet fiable.
Concernant les programmes de formation, la situation est encore pire. Les programmes officiels sont presque inexistants, les descriptifs, les compétences et les contenus des cours ne sont toujours pas accessibles aux étudiants et aux professeurs. Il n’y a pas d’organe ou d’entité qui se charge systématiquement de l’évaluation, de la validité et du respect des plans de cours.
C’est dans ce contexte que l’Institut des Sciences, des Technologies et des Études Avancées d’Haïti (ISTEAH) a vu le jour en 2013. Il avait pour objectif de décentraliser la formation universitaire aux 2e et 3e cycles tout en offrant des programmes répondant aux besoins du pays. Il se donnait pour mission de former des scientifiques, des professionnels et des cadres responsables en visant rigueur, compétences et excellence.
Étant parmi les premiers bénéficiaires de la formation doctorale à l’ISTEAH, dans les sections suivantes, je fais une brève description de ma formation académique. Le résumé de ma thèse ainsi que mes expériences professionnelles avant et après l’obtention du diplôme de doctorat sont présentés. J’explicite mes motivations à entreprendre une étude doctorale à l’ISTEAH, la valeur ajoutée de cette formation, le lien de cette formation avec une Haïti nouvelle. Enfin, je présente une conclusion suivie de perspectives.

ISTEAH, l’apprentissage mobile comme levier de transformation de l’enseignement supérieur en Haïti
Écrit par Rico CHÉRISTIN
Nous comptons parmi les pionniers de l’Institut des Sciences, des Technologies et des Études Avancées d’Haïti (ISTEAH), faisant partie des 11 docteurs et 3 docteures ayant été formés depuis sa création en 2013. Notre appartenance à la première cohorte d’étudiants de cette institution prestigieuse est une source de fierté et d’engagement envers l’excellence académique. Fortement enraciné dans le domaine de l’éducation dès le départ, nous avons saisi avec enthousiasme l’opportunité offerte par l’ISTEAH d’approfondir notre expertise en nous spécialisant dans l’intégration des technologies éducatives. Cette orientation a tracé notre parcours, nous conduisant à explorer des horizons variés tels que la formation à distance, l’apprentissage mobile et les technologies éducatives novatrices. Notre objectif constant a été de catalyser des changements concrets et mesurables en faveur de l’amélioration du système éducatif en Haïti.
Les expériences accumulées tout au long de notre parcours académique, les découvertes issues de nos recherches approfondies et notre engagement actif sur le terrain nous offrent une compréhension holistique des enjeux cruciaux auxquels le système éducatif haïtien est confronté. Ces connaissances sont également le socle sur lequel nous tentons de bâtir des approches novatrices et réfléchies pour relever ces défis de manière durable.
Dans les sections suivantes, nous allons exposer notre cheminement académique, le condensé de notre thèse de doctorat, ainsi que notre expérience professionnelle, qui a contribué à forger notre vision et nos compétences. En parallèle, nous allons mettre en lumière notre motivation profonde et décrypter la valeur ajoutée que notre formation doctorale à l’ISTEAH a insufflée à notre parcours.
En définitive, notre objectif résolument tourné vers l’avenir est de démontrer en quoi cette formation rigoureuse a été un tremplin pour notre préparation à exercer un rôle significatif dans la nouvelle Haïti dont nous rêvons tous.

Un parcours académique et professionnel construit en Haïti au service de son pays
Écrit par Omilty DORVAL
En réponse au tremblement de terre dévastateur du 12 janvier 2010, le Groupe de réflexion et d’action pour une Haïti nouvelle (GRAHN) a, entre autres, pris l’engagement citoyen de former 1000 scientifiques comme contribution à la reconstruction du pays. La création de l’Institut des Sciences et des Technologies Avancées d’Haïti (ISTEAH) répond à cet objectif. Omilty DORVAL, originaire de l’arrondissement de Mirebalais dans le département du Centre, est le huitième docteur diplômé par l’ISTEAH depuis sa création en 2013, après Jacques ABRAHAM, Jean Judson JOSEPH, Jean Michel CHARLES, Fania OGÉ VICTORIN, Rico CHÉRISTIN, Joël CLAIRÉSIA et Irvings JULIEN.
Une fois terminés sa scolarité doctorale, son examen de synthèse oral, sa thèse a été acceptée le 11 mai 2021 par un jury de sept membres. La cérémonie de collation des grades a eu lieu à Génipailler le 28 mai 2021. Cet article dressant le profil de ce diplômé est une contribution à ce numéro spécial mettant en valeur les docteur.e.s formé.e.s par son alma mater dans le cadre de la célébration de son dixième anniversaire. Il présente sa formation académique incluant ses études doctorales à l’ISTEAH, un résumé de sa thèse, ses expériences professionnelles, sa motivation à poursuivre des études doctorales à cet institut, la valeur ajoutée de sa formation ainsi que la contribution éventuelle de celle-ci à l’émergence d’une nouvelle Haïti.
Mots clés : capital humain, motivation, réflexivité, valeur ajoutée, nouvelle Haïti.

ISTEAH: un choix pour la nouvelle Haïti
Écrit par Rony FRANÇOIS
Le souci d’amélioration de nos pratiques professionnelles nous a conduit à un processus d’autoévaluation, de remise en question ou encore de réflexivité. Cette démarche a abouti après plusieurs années dans le monde éducatif haïtien à l’entrée à l’Institut des Sciences, des Technologies et des Études Avancées d’Haïti (ISTEAH). Un choix bénéfique qui est passé par une phase de déconstruction pour nous conduire à l’intériorisation des grandes valeurs d’une citoyenneté responsable et transformatrice comme fondement de la nouvelle Haïti. En effet, l’ISTEAH, par la masse critique de professeurs et de cadres bien formés, devient incontournable dans la construction de cette nouvelle Haïti.

La supervision pédagogique au regard de l’enseignement-apprentissage dans le Sud d’Haïti: quelles pratiques pour quels résultats ?
Écrit par Jean Lucner TIMOGÈNE
La supervision pédagogique représente pour nombre de professionnels de l’éducation un instrument susceptible de favoriser l’amélioration du processus enseignement-apprentissage, garantissant ainsi la réussite scolaire des élèves. Une recherche de type exploratoire a été menée dans le département du Sud d’Haïti afin d’analyser les pratiques de supervision pédagogique au regard de l’enseignement-apprentissage, plus précisément au troisième cycle fondamental. La méthode qualitative d’inspiration phénoménologique a été priorisée et l’analyse du contenu des verbatim a été effectuée à l’aide du logiciel N’vivo. Les résultats indiquent que les participants ont une perception positive de la supervision pédagogique et la considèrent comme un atout majeur pour l’enseignement-apprentissage. Ils croient, cependant, que telle qu’elle est pratiquée dans le département et en particulier au troisième cycle, elle ne peut aucunement garantir l’amélioration de l’enseignement-apprentissage.

Un engagement pour la transformation de l’homme et de la femme en Haiti par l’éducation
Écrit par Magdala JEAN BAPTISTE
Traditionnellement, en Haïti, la place d’une femme se trouve au foyer pour s’occuper de la maison, des enfants et du mari. Une fois les études de base terminées, il est difficile pour les jeunes filles d’entamer des études supérieures. Les filles sont condamnées à suivre le modèle qu’inflige la société. Il est rare qu’elles intègrent les activités intellectuelles et scientifiques. C’est dans ce sens qu’à partir des lectures sur la lutte et l’autonomisation des femmes et suivant les conseils de quelques professeurs, Magdala Jean Baptiste a commencé à s’intéresser et à prendre part à des activités intellectuelles et scientifiques. Des lectures ont poussé sa curiosité à apprendre davantage. Aller à l’école, discuter et échanger avec les autres la fascine. Elle est toujours en train d’apprendre de nouvelles choses.
Beaucoup d’embûches se sont présentées sur son chemin. Cela n’a pas du tout été facile avec les découragements de part et d’autre, car pour son entourage, il n’y a pas d’intérêt à ce que les femmes continuent à apprendre. Pour avancer, il est important d’avoir beaucoup de courage et de persévérance. Cependant, il est clair, vu toutes les profondes transformations économiques et sociales que subissent actuellement les sociétés, qu’elles seront dans l’incapacité de subsister sans la présence des femmes. L’objectif du développement durable ODD5 mentionne l’importance de parvenir à l’égalité des sexes et d’autonomiser toutes les femmes et les filles. La société évolue avec la participation des femmes dans des activités économiques et sociales. Cette participation détermine la qualité de la société.
Les sociétés et les gouvernements ont donc une obligation envers les prochaines générations, celle de mettre au point des systèmes qui garantissent de bonnes compétences parentales, qui favorisent l’épanouissement du jeune enfant et qui tiennent compte des facteurs socio-économiques associés à une économie en pleine évolution et de la participation grandissante des femmes dans la population active. L’homme ainsi que la femme doivent acquérir les compétences nécessaires pour contribuer à une économie mondiale robuste et en constante évolution. Investir dans le capital humain consiste à améliorer la nutrition, la santé, la stimulation et les soins, et favorise le développement individuel, la richesse nationale et la croissance économique. Cet investissement permet de mettre fin à l’extrême pauvreté et de réduire les inégalités sociales.
En raison de la discrimination, de l’accès insuffisant à l’éducation, à la formation, aux actifs, et de barrières culturelles entravant leur engagement, les femmes n’ont souvent pas les mêmes opportunités de formation et d’emploi que les hommes. Magdala Jean Baptiste est arrivée à défier toutes ces difficultés et a entamé des études supérieures jusqu’à l’obtention de son doctorat. Les lignes suivantes présentent son parcours académique et professionnel et sa motivation à entamer des études supérieures.

Mes études doctorales à l’ISTEAH, une valeur ajoutée pour Haïti et la communauté scientifique
Écrit par Bellita BAYARD
La crise socio-économique, politique et éducative que traverse Haïti est non seulement récurrente, mais aussi tributaire d’un certain nombre d’aléas naturels tels que le séisme du 12 janvier 2010, des désastres cycloniques saisonniers, etc. L’accélération de ces phénomènes naturels, économiques, sociaux et environnementaux empêche le développement de la société haïtienne tant sur le plan éducatif que de la connaissance scientifique et de l’innovation. Ces problèmes structurels sont dus à la rareté des modèles typiques de production de connaissances scientifiques au service du pays.
Pour sortir de ce bourbier et de cette instabilité, le pays a besoin d’investissements en éducation de base, professionnelle et universitaire. Un transfert de savoirs, de connaissances scientifiques, technologiques, techniques, s’avère nécessaire. Il est important de nous interroger sur le modèle d’éducation à concevoir, dans une perspective de développement durable. Nous avons besoin de têtes pensantes et de matière grise à tous les niveaux sur le plan scientifique, en vue de prêter main-forte dans une perspective de développement du pays. Car la formation de la société haïtienne et des jeunes en particulier repose sur le partage des connaissances, le transfert de savoirs, de technologie et de savoir-faire.
Notre réflexion s’inscrit dans une perspective de la reconstruction d’une nouvelle Haïti, capable de faire face à ces défis techniques et structurels. Le peu d’intellectuels dont dispose le pays est obligé, en raison du chômage et du sous-emploi, de partir sous d’autres cieux en quête d’un mieux-être, ce qui entraîne une fuite de cerveaux chronique et à outrance. La situation actuelle d’Haïti représente également un facteur de vulnérabilité de sa capacité de production, qui a impacté ses économies. Par exemple, il y a une large insuffisance d’infrastructures et de compétences au niveau des services de base (eau, énergie, électricité, transport, gestion des déchets, urbanisation, techniques agricoles). De plus, le sous-sol est quasiment inexploité, ce qui entrave le décollage du pays vers la modernité prônée sur l’échiquier mondial.
Pour contribuer à relever ces défis, un groupe d’Haïtiens conséquents et responsables de la diaspora se sont réunis dans le but de former le Groupe de réflexion et d’action pour une Haïti nouvelle (GRAHN) et l’Institut des Sciences, des Technologies et des Études Avancées d’Haïti (ISTEAH) afin d’apporter leur contribution à l’éventuel développement et avancement d’Haïti. Ils ont prôné une possible nouvelle Haïti. À ce titre, ces acteurs se sont donnés à fond en vue de matérialiser leur rêve en créant l’ISTEAH, une école de technologies de l’information et de la communication et d’études en sciences économiques et sociales. Ils ont intégré la formation à distance en vue d’atteindre le maximum de personnes possible désirant acquérir des connaissances scientifiques au profit du développement du pays.
Une telle initiative est louable. Elle nous interpelle, et ce, pour plusieurs raisons. Non seulement nous avons constaté de grands atouts en faveur d’Haïti, mais aussi elle nous motive plus que jamais à adhérer à cet ambitieux projet, en tant que fille authentique du pays. Ce qui nous permettra d’apporter également notre contribution pour la concrétisation d’un rêve commun et cher à tous.tes : une Haïti nouvelle. Avant d’aller plus loin dans nos réflexions, nous aimerions dire à nos lecteurs qui nous sommes.

De l’étudiant en DESS au docteur en sciences de l’éducation à l’ISTEAH: un parcours atypique
Écrit par Élifaite GUE
Il n’y a pas de développement véritable dans un pays sans des citoyens bien formés sur la réalité socioéconomique et politique de leur territoire. Imprégné de cette conviction, le docteur Samuel Pierre a implanté l’Institut des Sciences, des Technologies et des Études Avancées d’Haïti (ISTEAH) dans le paysage universitaire haïtien en 2013. L’institution a pour mission de former des professionnels de haut niveau dans plusieurs domaines scientifiques.
Après dix années de fonctionnement, l’ISTEAH a déjà mis sur le marché 14 docteurs et plusieurs autres diplômés, que ce soit au niveau du diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS), de la maîtrise et bientôt, de la licence. Je suis l’un des heureux bénéficiaires de la formation de cette prestigieuse institution universitaire puisque je fais partie de sa deuxième cohorte d’étudiants. En effet, j’ai intégré l’ISTEAH en 2015. À partir de cette date, une nouvelle aventure s’offrit à moi, qui dura huit années consécutives.
Tout d’abord, j’ai entrepris des études en sciences de l’éducation, option gestion des systèmes éducatifs. À la suite de ma scolarité, j’ai obtenu mon DESS en 2017. Ensuite, en 2020, j’ai décroché mon diplôme de maîtrise en gestion des systèmes éducatifs. Enfin, en 2023, j’ai achevé mon parcours en décrochant mon diplôme de doctorat en sciences de l’éducation. Ce fut donc une réussite.
Cependant, l’aventure à l’ISTEAH n’était pas en soi ma première initiation universitaire. Car j’avais déjà effectué des études antérieures. En effet, j’avais déjà obtenu une licence et une maîtrise avant mon entrée dans cette nouvelle institution. Mon choix de mener des études doctorales à l’ISTEAH ne s’est pas fait à la légère. Car il s’avère qu’il correspondait à mes objectifs professionnels. D’où ma motivation à m’y inscrire.
Dans les lignes qui suivent, je présenterai ma formation académique ainsi que le résumé de ma thèse de doctorat. Ensuite, je ferai état de mon expérience professionnelle, avant d’expliquer ma motivation à m’inscrire à l’ISTEAH en vue d’y entreprendre des études doctorales. Puis je décrirai les valeurs ajoutées de la formation doctorale et j’établirai les liens entre cette formation et l’Haïti nouvelle. Enfin, je formulerai ma conclusion, accompagnée de quelques éléments de perspectives.